1941.
Les Allemands avaient
conçu un vaste plan d’encerclement du Proche-Orient afin de disposer de son
précieux pétrole. Le 2 mai 1941, l’amiral Darlan accepta que l’aérodrome
d’Alep, en Syrie, fût mis à la disposition des force armées du Reich.

Si ce n’était pas là
de la basse collaboration, qu’était-ce d’autre ?
Mais ce n’était pas
tout dans la vilenie. Le 27 mai, le dauphin du maréchal Pétain accorda aux
nazis l’utilisation du port de Bizerte ainsi que la voie ferrée Bizerte-Gabes
en Tunisie.

Parallèlement, le 8
juin, tandis que les forces françaises libres attaquaient la Syrie, Franz von
Hauerstadt, enfin rétabli, rejoignait le front en Cyrénaïque.
Les parents du jeune
homme avaient appris avec des sentiments divers et ses blessures et sa
guérison. Si Amélie manifestait à la fois son soulagement et son amour pour son
fils, Karl se montrait beaucoup plus dubitatif.
- Cet idiot n’est
donc pas mort, finalement…
- Karl, vous ne
comprenez pas la situation de Franz. Son comportement est la garantie de notre
liberté.
- Comment cela ?
Vous dites n’importe quoi, ma femme !
- Mais non, mon
chéri. Voyez combien Peter est dans le collimateur de ces gens-là. Vous faites
souvent preuve d’imprudence dans vos propos. Martha, la cuisinière, les a
rapportés aux autorités.
- Et alors ?
Vous l’avez renvoyée, j’espère ?
- Je ne l’ai pu.
- Diantre !
Pourquoi ?
- Si je l’avais fait,
à l’heure actuelle, nous croupirions en prison.
- Vous vous faites
des idées.
- Je vous demande de
réfléchir. Nous sommes en danger… Que vous le reconnaissiez ou non.
- A qui la
faute ? Qui a fait monter au pouvoir cette racaille ? Hein ?
Dites-le-moi, ma chère ? Des individus comme mon fils !
- Karl, ne vous
emportez pas davantage. Cela nuit à votre santé.
- Ma santé…
justement, parlons-en. Les potions que vous me faites avaler sont inefficaces…
- Je n’y suis pour
rien, Karl. Le médecin n’a pas mieux à sa disposition. Les médicaments et les
soins sont prioritairement administrés aux soldats.
- Bravo ! Mais à
quoi s’attendre d’autre avec cette horde d’assassins qui nous gouverne ?
Il était de plus en
plus pénible pour la duchesse de supporter l’humeur massacrante de son époux. A
cela se rajoutait le souci du comportement de Peter. Très mal noté au sein de
son régiment où il terminait ses classes, le jeune homme n’allait pas tarder à
être affecté dans un bataillon disciplinaire.
*****
Juin 1941.
Cyrénaïque.


Infirmerie des
prisonniers britanniques et français aux mains de l’Afrikakorps, quelque part à
quelques kilomètres des lignes de combat.
Le soir laissait
place à la nuit et les étoiles scintillaient dans un ciel d’une pureté rare. La
chaleur se faisait moins accablante. Peu à peu la fraîcheur lui succédait,
phénomène normal sous ces latitudes.
Le commandant Raoul
de Frontignac, l’œil aux aguets, surveillait l’infirmier allemand en train de
prendre connaissance des directives du médecin major. Tout en s’acquittant de
sa tâche, l’aide-soignant annotait les ordonnances au mieux, selon les
médicaments qu’il savait être à sa disposition dans les réserves du labo.
Raoul, le bras gauche
simplement en écharpe, se défit de son pansement, et, mettant à profit
l’inattention de l’Allemand, passa la porte de l’infirmerie. Alors, il se retrouva
dans un couloir désert, éclairé chichement. Lentement, le fugitif avança,
prenant mille précautions, le cœur battant fort dans sa poitrine. Soudain, il
perçut des bruits de pas. Quelqu’un venait. Certainement un de ces foutus
Boches ! Par chance, le commandant avisa la buanderie. Il poussa la porte
du local et se cacha à l’intérieur. Il eut juste le temps de se dissimuler
derrière des panières emplies de linge.
Le médecin ne fit pas
cas du fait que la buanderie était ouverte. Il poursuivit son chemin comme si
de rien n’était.
L’alerte passée,
Raoul revint dans le corridor. Maintenant, plus qu’une porte à franchir et il
se retrouverait à l’extérieur du bâtiment. Mais il n’en avait pas pour autant
la partie gagnée.
Néanmoins, il
franchit sans encombre le seuil, magnifique de sang-froid car, à droite de
l’entrée, se tenait en faction une sentinelle. Heureusement pour le commandant,
le soldat ronflait dans son casque.
A petits pas
silencieux, Frontignac s’engagea sur le sol pierreux de la cour qui menait à un
grand bâtiment dans lequel étaient enfermés les simples soldats faits
prisonniers par les nazis.
Tout autour du camp,
plusieurs rangées de fils de fer barbelés étaient censées empêcher, du moins en
théorie, toute évasion. De plus, à chaque point cardinal un mirador se
dressait, bâti précaire à l’intérieur duquel des soldats veillaient munis de
projecteurs puissants.
Pour l’heure, Raoul
jouait d’une baraka du tonnerre. Il avait pu glisser dans les poches de sa
vareuse des cisailles avec lesquelles il escomptait pouvoir couper les fils.
Cet outil avait été volé à un ouvrier venu réparer la tuyauterie de
l’infirmerie.
Frontignac n’avait
pas encore été aperçu par les guetteurs. Cependant la zone réellement
dangereuse n’était plus qu’à quelques pas. Résolument, il s’y engagea, n’étant
pas dans ligne de mire des projecteurs qui, en cet instant, ciblaient le
bâtiment où les simples soldats aux mains de l’Afrikakorps dormaient ou, du
moins essayaient.
Malgré son bras qui
le handicapait, le commandant se mit à ramper, à zigzaguer en direction des
barbelés.
Soudain, des
gémissements firent frémir le silence de la nuit. Les chiens de garde avaient
flairé l’étranger. A ces gémissements succédèrent bientôt des jappements et des
aboiements. Puis ce furent des grattements de griffes et une course effrénée
sur le sol caillouteux.
Enfin, un
Feldgendarme hurla, commandant à ses chiens :


- Ruhe !
Mais les deux chiens
n’eurent cure de cet ordre et aboyèrent de plus belle.
- Taisez-vous, nom de
Dieu, gronda le maître-chien. Il n’y a rien d’autre que le silence de la nuit.
Cependant, le
militaire entendit enfin comme un bruit de reptation à quelques dizaines de
mètres de lui. Peinant pour retenir ses bêtes, il parvint néanmoins à se saisir
de sa torche et à éclairer la source de ce bruit intempestif. Raoul se retrouva
pris dans le rayon lumineux.
Le premier réflexe du
Feldgendarme fut de crier :
- Alarm !
Son second de siffler
l’alerte.


Aussitôt, la sirène
retentit, vrillant les tympans. Les miradors orientèrent leurs projecteurs vers
les bâtiments mais également l’espace désert précédant les barbelés.
Pendant ce temps, les
soldats de service, s’emparant de leurs armes, accouraient à l’extérieur.
Le Feldgendarme,
quant à lui, au lieu de tirer, avait lâché ses chiens contre Raoul de
Frontignac. Toutefois, ce dernier, jouant son va-tout, s’était relevé et
courait maintenant tout en tentant d’échapper à la fois aux lueurs aveuglantes
et aux bergers allemands. Lorsque les bêtes furieuses furent sur lui, Raoul,
qui avait également volé un Luger tira sur elles, les abattant sans le moindre
remords.
Mais l’étau se
resserrait inexorablement. Pas la peine de poursuivre en direction des
barbelés, pourtant à cinq mètres.
- Foutue
lumière ! Gronda Raoul, comprenant qu’il allait être rattrapé et descendu.
Cela dit, visant un
des miradors, il fit feu sur un projecteur, rendant momentanément aveugles les
deux gardes qui le cherchaient. Une des sentinelles, atteinte par une balle en
pleine tête, s’effondra sur son camarade, le rendant inapte à répliquer.
Cependant, les fusils
et les mitraillettes des autres soldats en faction crépitaient. Le commandant
fugitif ne pouvait qu’être descendu par ces fichus Chleus !
Alors que les
Feldgendarmes se rapprochaient, soudain, le mortel crépitement cessa. Une main
ferme se posa sur l’épaule du prisonnier qui avait presque réussi à se faire la
belle.
Se retournant
vivement, Raoul vit devant lui un jeune officier allemand, en uniforme
immaculé, mais tête nue, un capitaine qui le menaçait de son Mauser.
- N’allez pas plus
loin, commandant, déclara le capitaine de l’Afrikakorps en un français
excellent. Il est préférable que vous vous rendiez.
- Me rendre ?
Devant les deux
hommes, se dressaient des soldats allemands, mitraillettes prêtes à tirer.
- Jamais,
fumier !
Raoul allait abaisser
son index sur son Luger et le coup partirait dans moins de deux dixièmes de
seconde. Cependant, ce fut le capitaine allemand le plus rapide car la balle du
Mauser fracassa deux doigts de la main droite du Français.
- Désolé, dit Franz
von Hauerstadt. Vous n’aviez pas l’air de comprendre. Veuillez lever les bras.
- Par Dieu ! Qui
êtes-vous ? Quel salaud de traître ?
Franz réitéra son
ordre, préférant ne pas répondre aux questions insultantes du commandant.
- Les bras en l’air.
Laissez tomber votre arme si vous ne voulez pas que je vous tue.
Frontignac fit
semblant d’obtempérer. Avait-il le choix ?
Le comte von
Hauerstadt s’approcha du prisonnier et commença à le fouiller
consciencieusement. Là, il découvrit, non sans une certaine surprise, les
cisailles.
- Bigre ! Vous
en avez encore d’autres en réserve ?
- Oui, rugit Raoul,
qui, usant d’une prise de judo, renversa Franz, l’envoyant rouler sur le sol à
quelques pas de lui.
Cependant, Frontignac
ne pouvait savoir que le capitaine allemand excellait lui aussi dans la
pratique des arts martiaux. Se ressaisissant, le jeune comte se redressa,
cherchant des yeux son arme qui était allée bouler à quelques mètres. Désormais
inaccessible, il lui fallait affronter à mains nues l’opiniâtre commandant français.
C’est ce qu’il fit. Les deux adversaires multiplièrent les prises, les
esquives, les assauts devant des Feldgendarmes figés, n’osant user de leurs
armes, craignant de blesser le capitaine.
Mais la chance parut
un instant se mettre du côté de Raoul car le commandant parvint à s’emparer du
Luger. Un dixième de seconde et Franz était mort. Or, ses sens exacerbés par le
désir de survivre, le jeune capitaine se jeta juste à temps dans les jambes du
commandant alors que, déjà, le coup partait. La balle siffla aux oreilles de
von Hauerstadt, lui dessinant une estafilade dans le cou. La lutte reprit.
Raoul dut laisser tomber une nouvelle fois son pistolet.
Devant, un
Feldgendarme perdait patience. Il fit claquer le chien de son fusil alors que
Franz était à deux doigts de récupérer son Mauser.
- Ne tirez surtout
pas ! Ordonna le capitaine von Hauerstadt au soldat.
Cette phrase eut pour
conséquence de permettre à Raoul d’envoyer un terrible coup de poing dans l’estomac
du jeune homme.
Vidé de son souffle,
Franz chercha désespérément de l’air dans ses poumons tandis tout son corps lui
faisait un mal de chien. Cependant, Raoul mit encore à profit la relative
faiblesse de son ennemi pour s’emparer du Mauser. Dans un rictus, il se saisit
de l’arme, mais, à sa grande surprise, ce fichu capitaine revenait à
l’assaut !
Les deux adversaires
roulèrent sur le sol pierreux et dur et soudain, un claquement dans la nuit. Le
pistolet était parti tout seul. Raoul de Frontignac, mortellement atteint,
agonisait.
Secoué, Franz se
releva, son bel uniforme éclaboussé de sang. Se rapprochant du mourant, il lui
murmura à l’oreille :
- Verzeihen Sie… Pardonnez-moi… Je ne
voulais pas votre mort… vraiment…
Avant de rendre le
dernier soupir, Raoul bégaya :
- Ce n’est pas votre
faute, capitaine. C’est cette foutue guerre…
- Je ne connais même
pas votre nom…
Mais Franz ne reçut
aucune réponse à sa dernière question. Raoul de Frontignac était mort.
Un Feldgendarme
accourut aider le capitaine von Hauerstadt à retrouver son équilibre.
- Ce commandant
français est mort en brave, jeta le jeune homme. Comment se nommait-il ?
- Raoul de
Frontignac, le renseigna le soldat.
- Un officier
courageux. Sa famille doit être prévenue. Au plus vite…
- Compris, capitaine.
- Maintenant,
laissez-moi… je n’ai pas besoin de vous…
- Mais, mon
capitaine…
- Je vous ai donné un
ordre, je crois…
- Jawohl, Herr Hauptmann…
Abandonnant son arme
sur la pierraille, Franz, tout en remettant de l’ordre dans sa tenue, regagna
le bâtiment dans lequel il logeait, des sombres pensées plein la tête.
- Combien de temps
vais-je devoir supporter cette situation ? Combien de temps vais-je
mentir ? Aux autres et à moi-même ?
*****
22 Août 1962. France.


Mais quel 22
août ? De quelle année 1962 ?
La scène se passait
sur une petite route près de Paris. Nous étions un dimanche soir. Deux
véhicules, une DS et une estafette stationnaient, attendant le passage du
convoi présidentiel. Lorsque le cortège fut en vue, le chauffeur de la DS fit
des signaux à l’estafette. Aussitôt, les occupants en sortirent et, avec leurs
mitraillettes, tirèrent plusieurs rafales sur les voitures officielles.


Sous les tirs, les
pneus de la voiture présidentielle éclatèrent tandis que l’automobile du chef
de l’Etat dérapa pour aller s’encastrer dans un pylône de béton. Celui-ci,
déséquilibré par la violence du choc, s’effondra sur la voiture noire, une DS
elle aussi, déclenchant un incendie qui, gagnant le réservoir d’essence,
entraîna rapidement une explosion.
On le comprend, il
était impossible de sortir vivant d’une telle série de chocs. Ce fut le cas
pour le Président, son épouse, son gendre ainsi que le chauffeur. Mais
qu’était-il advenu de l’autre véhicule protégeant la voiture officielle du chef
de l’Etat qui s’en revenait d’un week-end paisible ? Lui aussi avait été
mitraillé par le commando. Le conducteur avait dû stoppé, grièvement blessé.
Alors, les attaquants s’étaient ensuite précipités et, après avoir ouvert
violemment les portières, avaient abattu les survivants sans regrets, des
hommes appartenant à la police secrète du général. Un véritable carnage dont
témoignait le sang souillant les banquettes en cuir.
Après cet assassinat
réussi, le chef du commando, le lieutenant Bougrenet de la Tocnaye se frotta
les mains de satisfaction et se dit :
- Les Français
d’Algérie sont vengés !
Or, simultanément
mais ailleurs, véritablement ailleurs, au cœur d’un éther indescriptible, dans
un décor surréaliste effrayant, l’esprit du Commandeur Suprême, lumière
violette parcourue de fulgurances bleues et oranges éprouvait soudain une
angoisse inattendue. Contenu dans une sphère noire, l’atmosphère qui
l’entourait virait au rouge pourpre, au rouge sang.
Une harmonique
temporelle étrangère au cours de l’Histoire voulu par le Grand Ordonnateur se
substituait à la chronoligne 1720. Sous le coup de ce bouleversement que rien
ne pouvait apparemment stopper, le Commandeur Suprême, l’Intelligence
Artificielle qui surveillait la civilisation post-atomique numéro 4, les Douze
Sages ainsi que toutes les créatures qui peuplaient cette Terre de cauchemar,
se mirent à fluctuer, oscillant entre l’existence et le non-être.
Juste à la femto
seconde précédant leur disparition, les Douze Sages, unissant leurs pensées,
parvinrent à transmettre une sorte de SOS à l’observateur temporel concerné
afin qu’il agît en urgence avec tous les moyens mis à sa disposition pour
rerouter la chronoligne.
Ce qui suivit fut
proprement prodigieux. Le Système solaire s’arrêta en pleine course un
millionième de seconde, pas davantage. La Terre, boule bleue et blanche
splendide dans le cosmos sombre, inerte, apparaissait comme suspendue dans le
vide, miracle de beauté.
Ledit agent capable
d’un tel prodige, l’élément extérieur, l’Entité se positionna, invisible, sur
le lieu même où l’attentat s’était produit, événement non anodin dans le
continuum temporel, pour faire repartir à l’envers la séquence sanglante
déroulée. A l’instant crucial où tout avait basculé, l’observateur modifia
imperceptiblement un des paramètres des acteurs. Maintenant, le film pouvait
reprendre le cours de son scénario.
A l’intérieur de la
DS assassine, le commando prévint un poil trop tard les occupants de
l’estafette. L’attentat du Petit-Clamart échoua de justesse. Ses conséquences
allaient entraîner une modification de la Constitution de la Vème République.
En effet, désormais, le Président serait élu au suffrage universel direct et
non plus indirect. Détail sans importance nous direz-vous. Que non pas !
Quant aux Français et
aux autre humains vivant dans cette deuxième moitié du XXe siècle, ils
ignoreraient que l’Histoire avait failli basculer dans le mauvais sens. La
crise des fusées de Cuba n’était pas loin et quelle aurait été alors l’attitude
de la France et de l’Europe dans celle-ci ? La partie de bras de fer entre
les Etats-Unis et l’URSS n’aurait peut-être pas connu la fin inscrite dans les
archives. Une fin qui avait évité la guerre atomique.
Là-bas, loin en aval,
le Commandeur Suprême félicitait les Douze Sages.
- Vous avez agi comme
il le fallait, avec une efficience méritoire. Ainsi, notre civilisation
a-t-elle été épargnée. Soyez-en loués.
- Remerciez plutôt le
Grand Ordonnateur, répliqua S1. Lui seul sait ce qui est, ce qui a été ou pas,
ce qui sera. En fait, nous ignorons tout de l’Avenir. Nous n’en voyons que des
probabilités. Nous nous contentons d’être les instruments dociles de la
Providence.
Qui était donc
intervenu silencieusement et incognito ? Un Michaël ? Fallait-il le
croire ? Même notre MX n’aurait pu parvenir à un aussi beau résultat en
cette fraction si courte de temps. Alors, qui s’en était mêlé ? Un
Observateur, oui, autrement dit l’Expérimentateur. Cette chronoligne 1720, il
tenait à ce qu’elle allât jusqu’à sa sombre conclusion. L’émergence des Homo
Spiritus.
Or, en 1993, Michaël
Xidrù, assis paisiblement devant l’ordinateur de Stephen Möll avait eu comme un
frisson rétrospectif. Il avait saisi que son Monde, son Univers avait failli
basculer et disparaître. Voyant que le Temps avait été remis en place, il esquissa
un léger sourire de soulagement.
Ensuite, il se leva
et d’un pas nonchalant, se dirigea vers le bar de Stephen Möll. Là, il se
servit deux doigts de scotch devant les yeux ébahis du professeur qui, à son
bureau, vaquait à ses occupations d’enseignant.
- Putain ? Que
se passe-t-il Michaël ? Qu’est-ce qui vous prend ? Jamais je ne vous
ai vu boire de l’alcool.
- J’ai juste besoin
d’un petit remontant… je dois me remettre dans un état euphorique…
- Bah !
Pourquoi ?
- Il n’y a rien eu de
grave… enfin… pas plus que d’habitude, Stephen. J’ai failli m’évaporer dans le
non-être. Comme tous mes contemporains d’ailleurs. Mais vous, vous n’auriez pas
été victime de cette harmonique apparue subitement, une harmonique non désirée.
Parce que vous étiez déjà né lorsque l’événement en question est survenu.
Quoique… s’il avait abouti à déclencher trop tôt la guerre atomique, on peut se
poser la question de savoir quel aurait été votre sort… vous aviez six ans en
1962…
- Je ne comprends pas
le moindre mot de vos propos, mon cher.
- Tant pis. Ceci dit,
le Commandeur Suprême a lancé l’alerte. C’est là une de ses tâches.
- Bof ! Alors,
cela signifie que vous lui devez la vie, quoi. Il vous a sauvé. Faut-il s’en
réjouir ? Grommela le professeur.
- Hum… Je n’en suis pas
encore là. Quant aux hommes robots, quelques-uns doivent se retrouver coincés
entre deux états, un peu comme le chat de Schrödinger.
- Pff ! Mieux
vaut en rire.
- Ma foi, vous avez
raison. Mon organisme ayant été quelque peu mis à mal, changeons-nous les
idées.
Avec une grimace,
Michaël avala son scotch.
- Cela déchire la
gorge et ça brûle.
- A quoi d’autre vous
attendiez-vous ? C’est fini, ce cirque ? J’ai des copies à corriger,
moi !
Effectivement, le
professeur Möll devait achever de noter quinze copies rédigées lors de la
session d’examens de septembre.
Comprenant que son
hôte désirait être au calme, l’agent temporel gagna la chambre où Aliette
sommeillait. Toutefois, il se garda bien de réveiller l’adolescente, se
contentant de l’observer et de capter quelques images de son rêve onirique.
*****
17 Juin 1941.
Le général Rommel
avait repris la Cyrénaïque aux Britanniques. Désormais, il n’était plus qu’à
cent-cinquante kilomètres d’Alexandrie. Mais le Führer avait bien d’autres
soucis en tête que les éventuelles défaites ou victoires de son Afrikakorps.
Le 21 juin,
l’opération Barbarossa était enclenchée. Avec pas mal de retard sur le
calendrier. Les plaines russes voyaient donc déferler les armées et les blindés
nazis.


Libérés en quelque
sorte de leurs atermoiements et de leurs scrupules, les communistes pouvaient
enfin se jeter ardemment dans la résistance sans craindre une entorse à leur
logique idéologique.
François Granier, qui
ne résidait plus à Sainte-Marie-Les-Monts depuis plusieurs semaines, et qui
n’avait plus non plus donné des nouvelles à sa famille, obtint des renforts
pour son coup de main contre la Kommandantur.
Pendant ce temps, le
dictateur allemand croyait bon d’informer son homologue italien de ce qui se
passait.
Duce,
je vous écris cette lettre au moment où des mois de délibérations angoissées et
d’attente pénible s’achèvent par la plus difficile décision de ma vie, je crois
– après avoir appris les derniers projets de la Russie et examiné de nombreux
rapports – que je ne peux pas prendre la responsabilité d’attendre plus
longtemps, et, surtout, je crois qu’il n’existe aucun autre moyen d’écarter le
danger – sinon d’attendre encore – ce qui conduirait immanquablement à un
désastre cette année ou l’année prochaine au plus tard.
Pour le Führer, le
danger pressait. Voilà comment on déforme l’Histoire. Ceci dit, il était tout à
fait vrai que Staline envisageait de retourner son alliance avec l’Allemagne
mais pas avant au moins l’année 1943… le temps que ses armées refissent leurs
forces…
*****
1er
Juillet 1941. Normandie.
Le groupe de résistants
de François Granier passait à l’action. Ses hommes avaient réussi à placer une
bombe artisanale dans un des bureaux du rez-de-chaussée de la Kommandantur, des
résistants travaillant pour la compagnie des téléphones, ayant pu pénétrer dans
le bâtiment aux mains de l’Occupant.
Cependant, l’engin
explosif était peu puissant. Il n’y eut donc que de légers dégâts matériels et
aucune victime à déplorer.
François ne savait
s’il devait ou non se réjouir d’un aussi piètre résultat. Cependant, le geste
acquerrait valeur de symbole. En attendant, les conjurés durent se cacher, la
Gestapo étant sur leurs traces.
Après quelques
semaines de traques, de jeu de cache-cache mortel, l’ex-préparateur en
pharmacie fut capturé par la police allemande. Son attitude plus que louche
auprès de sa logeuse avait éveillé la méfiance de celle-ci. La sexagénaire
l’avait donc dénoncé aux autorités. Arrêté, le jeune homme fut conduit à Paris
afin d’interrogatoire.
*****
7 Septembre 1993. New
York.
Johann van der
Zelden, celui de 1995, recevait un message du Commandeur Suprême.
Confortablement installé dans son bureau tout en haut de son gratte-ciel,
l’Ennemi regardait un match de Hockey sur son poste de télévision. Sans montrer
sa contrariété à être ainsi interrompu dans ses activités de loisirs, le
financier écouta ce que lui disait son supérieur.
- Le destin de
Michaël sera bientôt consommé. Pour moi, il est déjà mort.
Van der Zelden savait
justement à quoi s’en tenir sur le sort incombé à l’agent temporel. Tout en
réprimant ses sarcasmes, il répondit :
- Il est vrai que les
Américains vont croire qu’il a trahi et qu’il est passé dans les rangs des
Soviétiques.
- Mon cher Johann,
avouez donc que j’ai donné un sérieux coup de pouce à l’Histoire, puisque l’ami
Michaël sera tenu pour l’un des principaux responsables de la Troisième Guerre
mondiale ! N’est-ce pas un magnifique paradoxe ?
- Oui, vous avez
raison, Commandeur.
- Désormais, chacun
des belligérants veut à tout prix s’accaparer des secrets du déplacement dans
les couloirs du Temps.
- Il y a du fun
là-dedans.
- Quant à vos
serviteurs, ces hommes synthétiques, je crois que tous les indices qu’ils
pourront récolter sur les continents Mû et Atlante ne nous apporteront pas
grand-chose en définitive.
Or, l’Ennemi fut
contraint d’interrompre le Commandeur Suprême car un de ses hommes robots
l’appelait en urgence. Aussitôt, jugeant les informations transmises par ce
serviteur docile importantes, il les transmit à l’Entité artificielle
positionnée en l’an 40 120.
Zemour Diem Boukir
venait de trouver des vestiges dignes d’intérêt à Palenque, au cours de la
célèbre expédition de 1952.


L’homme synthétique
avait la certitude que l’homme enterré dans la pyramide de Palenque était en
fait un des derniers descendants dégénérés des Atlantes. Mais ce n’était pas tout.
Il lui fallait en avoir la preuve définitive.
- Je dois me rendre
dans le passé une fois encore, disait Zemour
- Ah ? Vous
comptez remonter loin dans le temps ?
- Assez maître.
Jusqu’aux environs de l’an 5 000 avant Jésus-Christ.
- Eh bien, soit.
- Merci, maître pour
cette confiance.
Ensuite, le rapport
fut communiqué au Commandeur Suprême.
Dans un de ses
circuits, l’Entité artificielle songeait qu’elle était en train de mener en
bateau son subordonné, ce clone du véritable Johann van der Zelden. En fait, ce
n’était pas seulement l’origine de l’Atlantide qui importait à l’Intelligence
synthétique mais l’emmagasinage intégral de l’Histoire de la civilisation
humaine dans toute sa diversité. Mais pourquoi un tel acharnement à vouloir
récolter toute l’Information ? Le Commandeur Suprême voulait savoir quel
était le but de son Existence… qui l’avait facilitée… une fois en possession de
toutes les données, il espérait bien pouvoir s’affranchir des derniers liens
qui le maintenaient encore subordonné aux Douze S. Ensuite, il n’aurait plus
qu’à effacer tout ce passé et à lui en substituer un autre, plus à sa
convenance, un passé différent où il serait entièrement le Maître du Jeu.
Ce que l’Entité
négative ne pouvait appréhender, c’est que dans cette partie, les dés avaient
été pipés dès avant le premier lancer, que tous les intervenants, officiels,
non officiels, portaient un masque et se dissimulaient derrière des avatars
plus ou moins réussis. Un jeu truqué à l’échelle cosmique.
Quant à Johann van
der Zelden, celui de 1995, il était bien prêt d’accéder à un autre niveau de
conscience, un niveau qui lui permettrait alors de comprendre qui il était
réellement. Lorsque cet instant surviendrait, une sorte d’Apocalypse, c’en
serait bien fini du Commandeur Suprême et de ses velléités de tout vouloir
contrôler.
*****
1 009. Tibet.


Il n’y avait pas que
Zemour Diem Boukir à être sur une piste intéressante. Itachi Baya Narduk, lui
aussi, accomplissait sa mission avec succès. Ainsi, suivant les dernières
instructions de l’Ennemi, il était parvenu à se faire initier dans un monastère
tibétain qui recelait bien des secrets.
Or, dans ledit
monastère se trouvait également de Deuxième Maître du Temps. L’être en avait
fait sa résidence permanente.
Accédant à une
connaissance interdite aux Occidentaux, Itachi fut à même d’établir le
rapprochement entre la science spirituelle des bouddhistes et les acquis de la
quatrième civilisation post-atomique. Un soir, conduit en personne par le
Deuxième Maître du Temps, il pénétra jusque dans le cœur d’un temple de
cristal, un cristal incorporé à même la roche qui l’entourait, un édifice bâti
à l’intérieur d’une montagne.
Après réflexions,
l’homme biologique en déduisit que les moines tibétains avaient reçu leur
enseignement soit des observateurs de la quatrième civilisation post-atomique,
soit d’une civilisation fort ancienne dont le souvenir remontait à la nuit des
temps, mais qui avait atteint le degré de sophistication de celle des Douze
Sages, usant des mêmes ressources technologiques et de la même source
d’énergie… mais pourquoi une telle civilisation avait-elle fini par
disparaître ? Pourquoi n’en restait-il aucune trace nulle part ailleurs
que dans ce temple ?
Chose étrange. Quelques-uns
de ces moines vivant dans ce mystérieux monastère arboraient des traits
européens, caucasiens.
Enfin, Itachi Baya
Narduk, qui avait effectué un précédent déplacement aux Indes, avait acquis la
preuve que les Hindous avaient bel et bien possédé à un moment de leur
évolution des armes proprement effrayantes, la bombe atomique et les rayons
laser. Le serviteur de Johann s’empressa de faire le parallèle avec ce qu’il
venait d’apprendre.
*****
12 Août 1941.
Le maréchal Pétain,
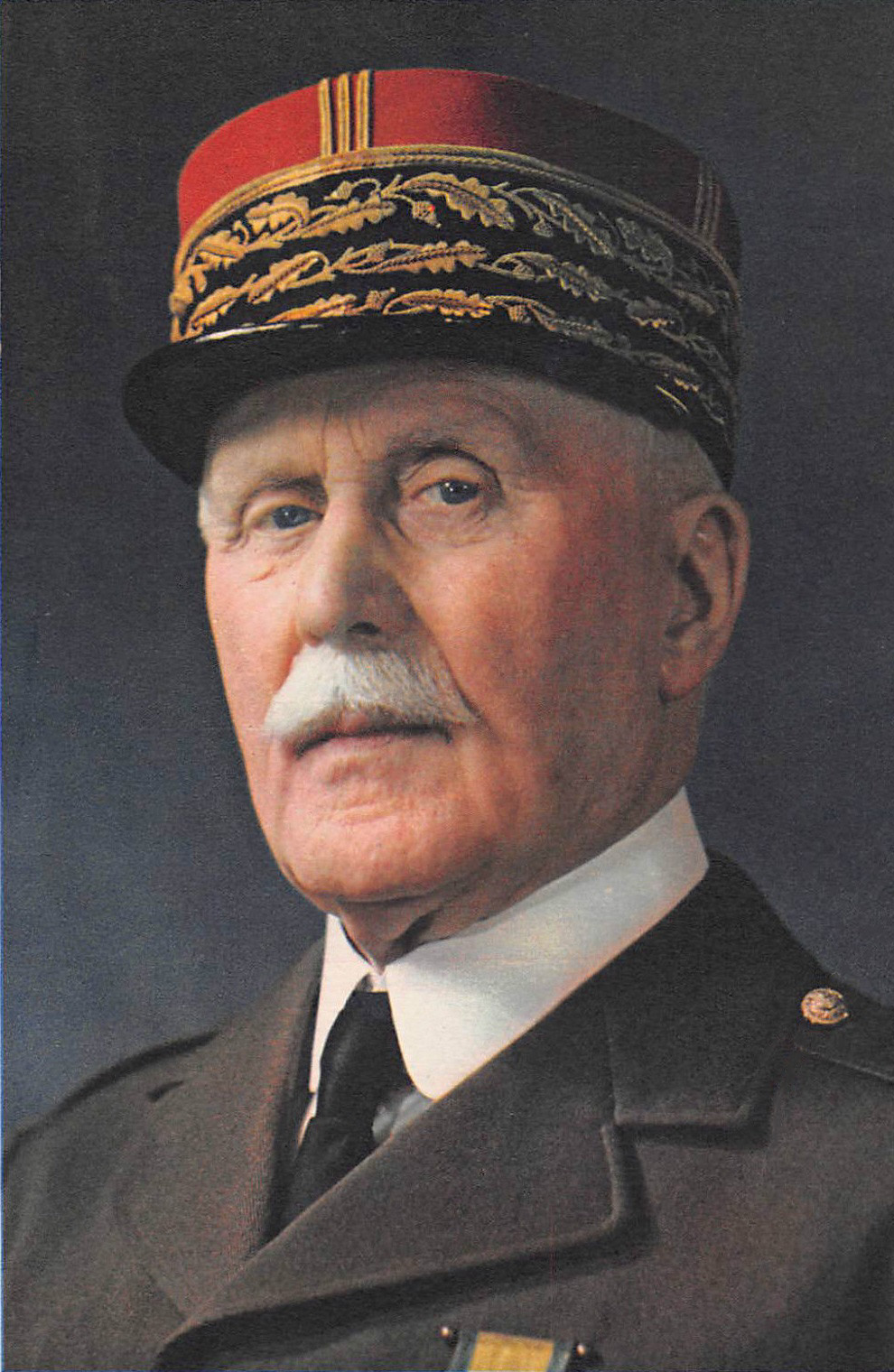
dans une allocution radiodiffusée, allocution particulièrement vigoureuse, soutenait à la population française meurtrie qu’il maintenait la politique de collaboration débutée à l’automne précédent. Puis, le chef de l’Etat français dénonçait le « vent mauvais » qui soufflait sur les esprits. Ainsi, il condamnait la résistance et annonçait l’institution d’une Haute Cour pour juger les responsables de la défaite.
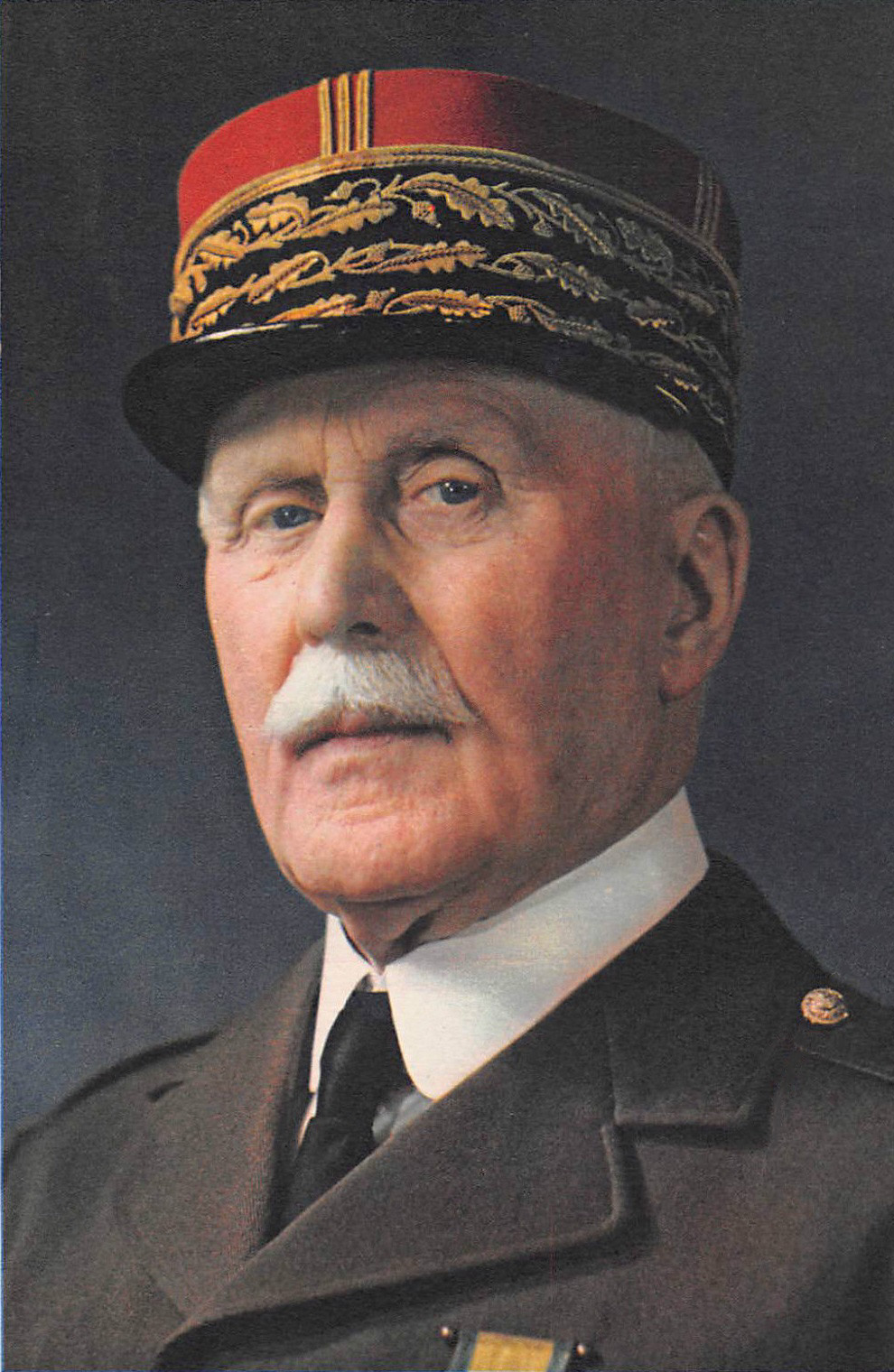
dans une allocution radiodiffusée, allocution particulièrement vigoureuse, soutenait à la population française meurtrie qu’il maintenait la politique de collaboration débutée à l’automne précédent. Puis, le chef de l’Etat français dénonçait le « vent mauvais » qui soufflait sur les esprits. Ainsi, il condamnait la résistance et annonçait l’institution d’une Haute Cour pour juger les responsables de la défaite.
Deux jours plus tard,
des tribunaux d’exception étaient mis en place afin de juger les terroristes.
La Collaboration atteignait un nouveau stade dans l’échelle de l’ignominie.
*****
Juillet 1941. Berlin.
Chancellerie.
Pour le capitaine
Franz von Hauerstadt, c’était l’heure de la gloire. En tenue de parade, le
jeune homme était salué et ovationné par toute une haie de soldats qui
célébraient les décorations reçues par les meilleurs officiers des forces
armées. Le Führer en personne participait à cette cérémonie.
Dans le vaste salon,
de taille inhumaine, tout illuminé, au plafond bien trop haut et aux murs d’une
hauteur impressionnante, les hauts dignitaires nazis s’avançaient pour se
concentrer vers leur guide, dans une débauche de couleurs, de médailles et de
dorures. Il y avait là Goering, Goebbels, Himmler, Bormann et enfin, Adolf
Hitler, la mine grave.


Raide et glacé, le
comte fut décoré par le Führer de la croix de fer, l’une des plus prestigieuses
récompenses. Le chef de l’Allemagne condescendit à complimenter ce brillant officier,
promis au plus grand avenir selon lui. Devant un millier de personnes, il donna
le jeune homme en exemple, exhortant les troupes qui combattaient à l’Est à
s’illustrer tout autant.


On aurait pu croire
que Franz était ému devant l’honneur qu’on lui faisait. Pensez donc !
Remarqué par le Führer qui avait promis de garder un œil sur sa carrière de
soldat… mais le capitaine était resté apparemment de marbre.
Après ce raout, le
capitaine Brauchischte prit son ami à part et le plaisanta sur son air sérieux.
- Allons donc, Franz.
Souris donc un peu ! J’aurais tant voulu être à ta place.
- S’il n’avait tenu
qu’à moi, je t’aurais laissé recevoir toutes les congratulations, Hans Werner.
- Tout de même… Si tu
poursuis ainsi à t’illustrer de la sorte, tu te retrouveras bientôt faisant
partie de l’O.K.W.
- Je n’en demande pas
tant.
- D’accord. Mais
toutes les récompenses sont bonnes à prendre, mon vieux.
- Oui…
Ce oui avait été
murmuré avec un léger doute. Mais à quoi donc pensait Franz en cet
instant ? Qu’est-ce qui le préoccupait donc tant ? Il venait tout
juste d’apprendre que son jeune frère Peter avait encore fait des siennes. En
représailles, il avait donc été transféré dans un bataillon disciplinaire. A
lui donc les missions suicides…
- Tout cela est de ma
faute, se morigénait intérieurement le capitaine. Il me faut donner encore
davantage de gages de mon dévouement au régime… Quelle mascarade ! Si je
suis ici, c’est parce que je l’ai bien cherché…
*****

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire