Noël 1918 ne fut pas véritablement
célébré par la famille von Möll, le décès de Wilhelm étant trop récent. Les von
Möll ne recevaient pas.

Néanmoins, Johanna, connaissant ses devoirs de
maîtresse de maison, rendit visite à quelques personnalités de Ravensburg. Pour
ces sorties, la jeune fille en deuil savait allier le chic à la tristesse. Elle
arborait une nouvelle robe noire à traîne en velours et hermine doublée de soie
bleue. Cette robe se relevait en V sur une jupe de tulle saumon brodée de
fleurettes noires. A la taille, quatre roses en bouquet et, sur le côté droit,
au bas du jupon, une guirlande de roses assorties à la couleur de la tulle.
Comme il se devait, la tenue était complétée par un chapeau noir en forme de
capeline agrémenté d’une guirlande de roses et d’un nœud pareil à la teinte de
la doublure de la robe. Quant aux pieds, ils étaient chaussés de lourdes
bottines noires.

*****
En ce mois de juillet 1993, deux
questions lancinantes obsédaient Stephen Möll.
Pourquoi Michaël disparaissait-il
ainsi ? Où se rendait-il précisément ?
Il fallait au professeur résoudre ce
mystère qui l’agaçait. Il en venait à oublier de corriger les copies d’examens
de ses étudiants.
Or, dans les rares moments de présence
de l’agent temporel chez lui, à LA, Stephen n’osait pas l’interroger.
Tant bien que mal, le chercheur
dissimulait et sa curiosité et sa nervosité à son hôte. Après tout, ce que
faisait ce dernier ne le regardait pas, non ? De toute façon, c’était à
peine si l’homme du futur prêtait attention à Stephen.
Après trois jours de cogitation, de
chewing-gums mastiqués, de sachets de pop-corn avalés, de canettes de soda
vidées, le professeur Möll crut pouvoir résoudre la manière dont il allait
pister l’agent temporel.
Alors que Michaël prenait sa douche
matinale, pour mémoire, l’homme du futur était pleinement incarné en Homo
Sapiens lorsque cela était nécessaire, le savant américain parvint à coudre à
l’intérieur de la ceinture du pantalon de l’agent temporel un mini pisteur
espion électronique relié à l’ordinateur portable de Stephen.
Michaël, en état dépressif, avait-il
donc perdu tous ses dons, et notamment celui de détecter le petit engin ?
Il disparut subitement, une fois sa
douche achevée, ignorant qu’il était pisté par le professeur.
Enfermé à clef dans son bureau,
Stephen eut vite les coordonnées du voyage temporel de son parent éloigné. 1187,
France, Soligny, Normandie.

- Gosh !
J’hallucine… mais que va-t-il foutre à cette époque si reculée ? dans
un trou pareil ? J’ignorais qu’il existait d’ailleurs… je ne le comprends
plus… maman pense qu’il est amoureux… elle a peut-être raison après tout… Il en
a tous les symptômes… ah ! La vache ! Si c’est le cas, dès son
retour, je lui administre la plus belle raclée de sa vie… Bon sang ! Lui a
le droit d’aimer une fille de ce passé barbare et moi je ne pouvais rester avec
Cécile ? Ce fumier va me le payer…
L’intuition d’Anna Eva avait été
bonne. Michaël, surmené, déboussolé à l’idée de la mission qui l’attendait,
stopper le maximum de missiles à têtes nucléaires afin d’épargner un maximum
d’Homo Sapiens de l’holocauste atomique, avait éprouvé de prendre un peu de
repos loin de ce XXe siècle fou, loin de toute technologie avancée.
Or, maintenant, après avoir multiplié
les visites dans ce coin perdu de Normandie, notre agent temporel ne pouvait
plus se passer de la présence d’une certaine damoiselle Aliette de Painlecourt,

héritière d’un solide château-fort muni d’escarpes, de contre-escarpes, d’un
fossé, d’un pont-levis, d’un donjon, de mâchicoulis, de créneaux et de tout le
bataclan… Chaque fois qu’il gagnait l’an 1187, il se sentait heureux,
nonobstant le père d’Aliette un baron tout puant et de son épouse, une matrone
de première…
*****
1919.
Lors de la Conférence de la Paix qui
se tenait à Versailles, le Président du Conseil français Clemenceau exigea des
réparations financières incroyablement élevées à l’Allemagne. Le pays fut
d’ailleurs reconnu comme unique responsable du conflit.
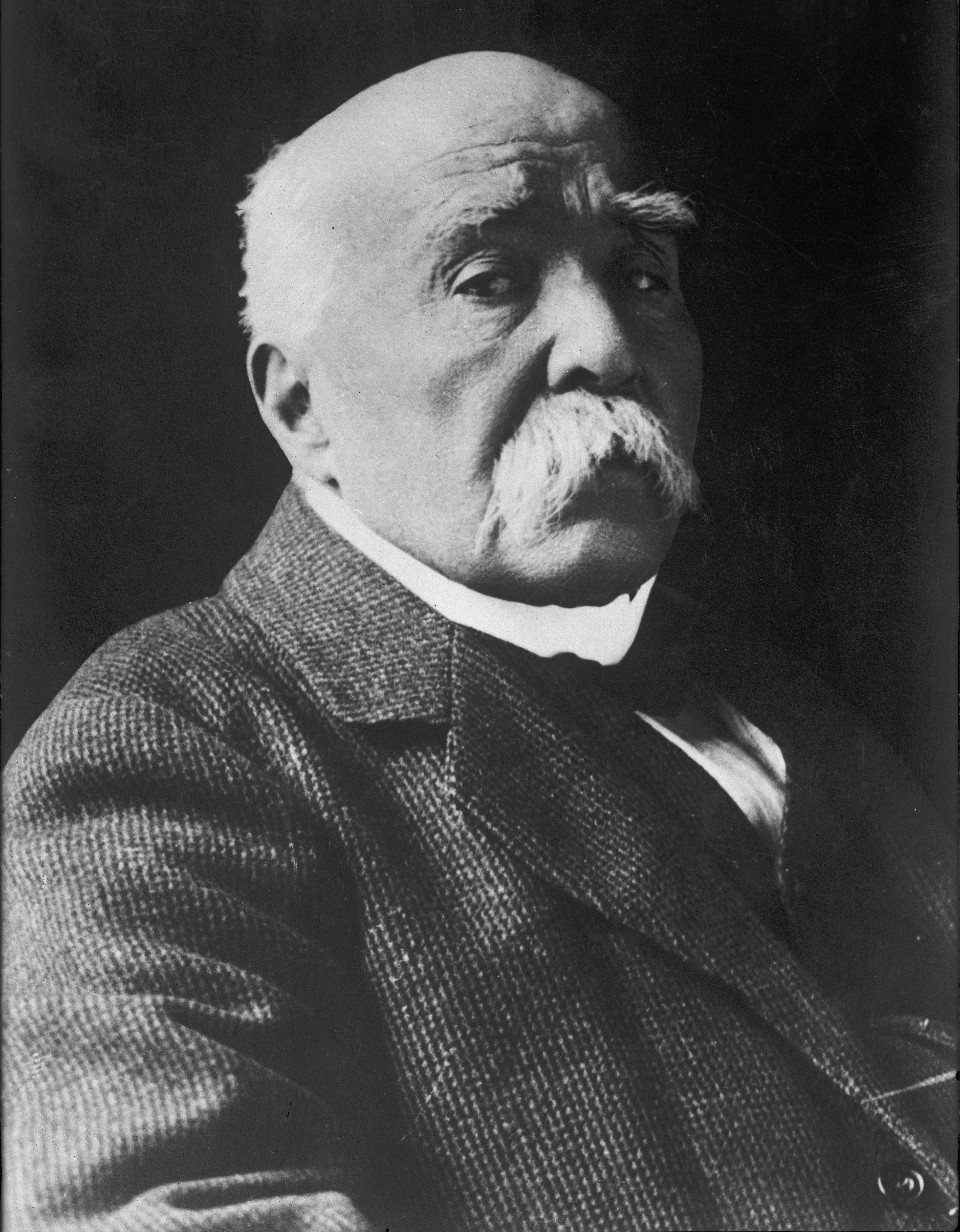
Or, aussi absurde que cela pût
paraître, David van der Zelden, qui, en tant que fiancé officiel de
mademoiselle von Möll résidait désormais à Ravensburg, approuvait l’attitude de
la France et le faisait hautement savoir. Mais pourquoi donc ?
Dans son for intérieur, notre
trafiquant d’armes pensait que plus Clemenceau se montrerait intransigeant,
plus son attitude allait exacerber la colère et le nationalisme des Allemands.
Alors, il y aurait une nouvelle guerre dont il souhaitait qu’elle ait lieu le
plus rapidement possible. Ainsi, il pourrait conclure de mirifiques contrats
qui établiraient sa réputation et l’enrichiraient davantage.
Johanna ne parvenait pas à saisir tout
cela, ces raisons machiavéliques affichées par David.

Les disputes s’enchaînaient. Mais
elles n’allaient pas jusqu’à rompre le lien qui unissait les deux jeunes gens.
- Mais David ! Enfin ! Vos
propos sont révoltants. Peut-être cela vient-il de votre nationalité
hollandaise ?
- Pas du tout, ma chère… je suis un
homme de sang-froid qui réfléchit posément et voit loin dans le futur.
- Vous ne pouvez réellement comprendre
ce que ressent dans son cœur et dans sa chair tout bon patriote allemand. Ce
dont je suis ! De plus, nous n’avons pas perdu cette guerre.
- Ah ? Comment cela ?
- Mais oui, David. Ce sont les
socialistes, les financiers et les ouvriers qui nous ont trahis. La juiverie
internationale…
- Euh… vous voyez des complots
partout, ma chérie. Ne vous mettez pas dans des colères pareilles. Cela nuit à
votre santé. Je suis certain que votre pouls bat trop vite en cet instant.
- Je m’en moque…
- Pas moi. Je suis soucieux de votre
bien-être. Mais je pense juste quoi que vous en disiez. Il est vrai que je n’ai
pas la nationalité allemande. Mais une chose me guide…
- Laquelle ?
- Mon amour pour vous. Je veux être
riche pour vous, pour ne pas vous faire honte et vivre à vos crochets lorsque
nous serons unis. Je vous aime tant…
- Oh ! David ! vous
réchauffez mon cœur. Mes mains glacées…
- Johanna, vous méritez ce qu’il y a
de plus beau, de plus luxueux. Les chaudes fourrures de zibelines ou de renards
bleus, les rivières de diamants, les dentelles les plus fines et les plus
travaillées. Vous devez vivre dans la haute société et ne pas rester cantonnée
dans cette bourgade si provinciale !
- Oui, c’est ce que je souhaite… mais,
pour l’instant, je suis enfermée ici, à cause de mon deuil. Je vous promets que
celui-ci achevé, j’irai à Berlin, en Suisse, sur la Côte d’Azur, à Monte Carlo…
- Je songeai surtout à la
fréquentation de salles d’opéras, à la jet set d’un soir de grande première,
aux repas mondains en compagnie des puissants de ce monde…
- Je n’y ai pas renoncé, mon cher… pas
du tout.
- Tant mieux. C’est pour que vous
puissiez briller dans la haute société que je passe mon temps à aligner des
colonnes de chiffres et à voyager par monts et par vaux.
- Oui, David, je comprends mieux. Mais
pas au prix de l’honneur allemand.
Piikin allait se mêler de rétablir la
paix dans le futur ménage. Ses ordres reçus étaient stricts. Il fallait à tout
prix que mademoiselle von Möll épousât le sieur David van der Zelden. Ainsi, il
parvint à convaincre Johanna de la justesse du raisonnement de son fiancé.
Après tout, l’Allemagne n’avait pas été vaincue sur son territoire.
L’incroyable insolence des Français allait réveiller le peuple germanique qui
vengerait magistralement l’armistice honteux de novembre 1918…
*****
Septembre 1935. Quelque part dans les
Alpes bavaroises. Dans le riche pavillon de chasse des von Hauerstadt.
Karl avait une dispute homérique avec
son fils aîné Franz. C’était bien la première fois que le jeune homme, âgé de
dix-sept ans le décevait ainsi. En effet, après avoir forgé un faux
vraisemblable, l’adolescent était parvenu à s’enrôler dans la toute nouvelle
Wehrmacht. Sur les papiers, il était dit que Franz avait dix-huit ans révolus.
- Franz, ce que vous venez de faire
est honteux.
- Honteux ? Je ne comprends pas.
Vous avez des mots durs, père. Honteux, prendre l’uniforme, s’engager dans
l’armée de la revanche ?
- Oui, honteux ! La Wehrmacht
n’est pas une armée digne des armées d’autrefois…
- Vous vous trompez. Je veux redonner
au nom des von Hauerstadt le lustre des siècles passés. Je veux être un soldat
de métier, un officier. Votre grand-père ne s’est-il pas illustré en
1870 ? Il ne s’est pas autant posé de questions. Il a compris où était son
devoir. Vous m’avez rabâché les oreilles de ses exploits durant des années.
Quant à votre homonyme, Karl, en 1814, il s’est illustré contre le général
Bonaparte…

- Franz, cette armée n’est pas l’armée
de l’Allemagne ! Elle est commandée par des bandits, des voleurs, des
soudards… elle a prêté serment de fidélité à ce Hitler, ce vagabond qui
désormais se trouve à la tête de notre malheureux pays.
- Ne parlez pas ainsi de notre
bien-aimé Führer ! Il saura rendre sa gloire à notre patrie.

- Vous croyez cela ? Vous êtes un
naïf, Franz. Qui vous a embrigadé ? Lessivé le cerveau ? Hans-Werner ? J’aurais dû mieux
surveiller vos fréquentations. Cette Wehrmacht n’apportera à notre pays que le
déshonneur. Vous verrez que j’ai raison. Mais il sera trop tard… Trop tard pour
l’Allemagne, trop tard pour vous… vous vous retrouverez souillé à jamais…
maudit peut-être… ah ! Vous brûlez de faire la guerre, de combattre…
contre qui d’abord ?
- Vous le savez fort bien, père…
- N’importe quoi, Franz ! Contre les
Français ? Mais votre mère est française… vos racines sont françaises.
- Oui, les Français actuels, père… ils
sont dégénérés, ne pensent qu’à faire la grève… Ils sont manipulés par les
Juifs… ils sont enjuivés eux-mêmes…
- Dieu du ciel ! Franz, vous entendez-vous
proférer ces sottises ? Ah ! Que de sornettes ! Vous buvez les
inepties de cet histrion, vous le voyez en sauveur, en messie… que sais-je
encore ? Ce qu’il faudrait à notre patrie, ce sont des hommes courageux
pour renverser ce dictateur, ce fou ! Des hommes capables de se battre
contre ces hordes de sauvages qui ont ensanglanté nos rues…
- Père, vous ne saisissez rien. Vous
appartenez au passé. Je fais partie de cette jeunesse qui n’a rien oublié, qui
veut forger un homme nouveau…
- Cette jeunesse qui a perdu tout sens
critique, qui ne fait plus la différence entre la liberté et la sujétion. Cette
jeunesse qui est robotisée… asservie à un usurpateur dément qui n’apportera à
l’Allemagne et au monde que du sang, des cendres et des larmes.
- Père, rappelez-vous 1918…
- Vous n’avez pas à me donner de
leçons. J’y étais sur le front, moi.
- Oui, vous avez accompli votre devoir
et même davantage… Rappelez-vous aussi 1923, combien nous avons alors été
humiliés… nous avons été vendus par l’aristocratie financière.
- Cette aristocratie financière qui
vous nourrit, qui vous vêt, qui vous fait profiter de tout le confort moderne…
mais quelle idée avez-vous donc de 1918 et de 1923 ? Votre tête est farcie
de mensonges. Ce Hans-Werner, je ne veux plus le voir ici, chez moi. Franz, je
vous somme de vous ressaisir, de vous réveiller.
- Je me trouve très lucide, père.
- Je vais mettre opposition à votre
enrôlement, Franz. Après tout, vous êtes mineur, vous dépendez de moi.
- Père, désolé de vous décevoir, mais
vous ne pourrez rien faire. Mon engagement est valable. Il n’y a que ma date de
naissance qui a été trafiquée. Hans Werner m’a affirmé que vous serez
impuissant à invalider mon enrôlement.
- J’essaierai malgré tout.
- Inutile, père.
- J’ai compris. Quand
partez-vous ?
- Dès demain matin, à l’aube.
- Dans ce cas… faites comme vous
l’entendez. Mais votre fanatisme vous a fait oublier votre mère. Vous ne rêvez
que de combats glorieux, prouesses courageuses et décorations… contre les
ennemis du Reich, contre votre seconde patrie… dites-moi, mon fils, ces ennemis
sont-ils réellement ces pauvres marchands, commerçants et artisans juifs ?
Ces socialistes pourchassés et enfermés dans les camps comme Dachau ? A
mes yeux, ils ne réclamaient qu’un meilleur niveau de vie pour leurs
semblables… Vous pensez à la Russie, sans doute… avec Staline… qui déporte tous
ces Koulaks, ces paysans, les opposants au régime… des opposants créés de toute
pièce.
- Oui, père…
- Mais avant tout, vous cernez les
Français, vous refusez le Diktat de Versailles.
- Tout à fait…
- La guerre, vous la souhaitez, vous
l’anticipez… oui, vous irez vous battre, contre votre oncle maternel, vos
propres cousins… peut-être vous retrouverez-vous un jour face à eux… alors,
aurez-vous le courage pour en descendre un, en abattre un comme un animal
nuisible ? Sur la Somme, sur la Marne, les proches de votre mère Amélie,
vous affronteront.
- Mère…
- Mère… oui, votre mère sera morte de
désespoir entre-temps…
- Je…
- Ah ! Vous ne savez plus quoi
dire, soudain…
- J’aime ma mère, monsieur, n’en
doutez pas.
- Dans ce cas, restez.
- Et me désavouer ? Jamais !
- Franz, ah, Franz ! Que puis-je
dire à Amélie ? Que je vous ai chassé parce que vous avez commis la plus
grande connerie ?
- Père !
- Oui, la colère me fait devenir
grossier. Partez, Franz, partez vite… je ne vous chasse pas mais…
- Mais quoi ? Je puis revenir
tout de même, pour voir ma mère au moins ?
- Oui, pour voir votre mère lors de
vos permissions. La maison vous sera toujours ouverte… mais, désormais, vous
n’êtes plus mon fils, et lorsque vous séjournerez ici ou ailleurs, dans une de
nos propriétés, je vous éviterai…
*****
En ce début d’été 1919, Waldemar et
Otto von Möll débarquaient enfin dans un port britannique. Ils avaient été
retenus longuement en Irlande qui connaissait une sanglante guerre
d’indépendance. Pour tous bagages, ils ne possédaient qu’une vieille valise
cabossée contenant leurs maigres effets. Waldemar n’avait en poches que deux
livres. Avec une telle somme, il était difficile d’aller loin, de se loger et
de manger. C’était tout juste le salaire hebdomadaire d’un policier londonien.
Courageusement, ils décidèrent de se rendre à pieds à Londres…
Pour y parvenir, ils durent travailler
dans les champs, dormir à la belle étoile, se transformer en chemineaux.
Puis, un matin d’août, les deux
Allemands renégats atteignirent la capitale londonienne. On leur aurait fait
volontiers la charité. Waldemar parvint à dégotter une sordide chambre meublée
dans le quartier de Soho.

Si Otto parlait plus que correctement l’anglais
malgré un léger accent teuton, ce n’était pas le cas de son père. En effet,
Waldemar avait effectué des études classiques sur le plan linguistique. Il
s’exprimait couramment en français, en latin et en grec, mais en anglais, il ne
connaissait que les termes techniques ou scientifiques.
Toutefois, les deux von Möll étaient
des battants. Le plus jeune réussit à décrocher une place de commis dans un
grand entrepôt de marchandises et sur son maigre salaire, une livre et demie
par semaine, il se mit à économiser afin de trouver un logement plus correct.
Waldemar, quant à lui, se plongea dans
l’étude de l’anglais. Le soir, à la faible lumière d’une ampoule de 25 watts,
il faisait ses exercices de langue alors que son fils se penchait sur des
livres de physique empruntés à la bibliothèque du quartier.
Prenant sur lui, le jeune homme de
vingt ans écrivit une lettre à la célèbre université de Cambridge, sollicitant
son admission en son sein en tant qu’étudiant boursier étranger. N’avait-il pas
réussi le concours d’entrée quelques années auparavant ?
Faisant jouer ses divers diplômes
obtenus tant à Berlin qu’à Munich, Otto parvint à son but. Waldemar y était
également pour quelque chose dans ce succès. En cachette d’Otto, s’humiliant,
Waldemar s’en était allé voir le doyen de l’Université de Cambridge et avait
plaidé la cause de son fils. Le vieil homme, gentleman d’autrefois, fit plus.
Il accorda aussi une place de répétiteur à monsieur von Möll, le fils cadet du
défunt baron Rodolphe von Möll avec qui il avait entretenu une relation
épistolaire durant deux décennies.
Ainsi, les ennuis financiers des deux
exilés prenaient fin.
Parallèlement, Johanna von Möll
épousait David van der Zelden le 5 août 1919.

Cependant, toute gaité était absente
lors de la célébration des noces de la plus riche citoyenne de la petite ville
de Ravensburg. En effet, aux côtés de la jeune mariée, ne se trouvaient que sa
grand-mère Gerta et sa mère Magda, la veuve du baron Wilhelm. Quant à David, il
avait invité deux cousins éloignés à assister au mariage. Avec embarras, il
avait dû expliquer aux von Möll qu’il était fâché avec le reste de sa famille à
cause de sa profession. Bien piètre excuse pour justifier l’absence de ses
géniteurs pourtant encore en vie.
Malgré une toilette luxueuse, une robe
toute en dentelles brodées et rebrodées, la jeune épousée ressemblait plus à
une poupée de porcelaine qui pouvait être brisée à tout instant qu’à une
heureuse mariée.
Or, cinq jours plus tard, malgré son
âge avancée, Gerta von Möll partit rejoindre son fils survivant Waldemar, à la
grande colère de sa petite-fille. Johanna ne parvint pas à dissuader son aïeule
de changer d’avis.
Pendant ce temps, les événements
historiques suivaient leur cours. Ainsi, en France, la chambre bleu horizon
voyait le jour, contentant les plus folles espérances d’une droite revancharde.
*****
14 Juillet 1993. France, Paris…
Un horrible attentat, dépassant les
bornes des dernières atrocités de ce XXe siècle finissant venait d’avoir lieu
lors du bal célébrant la Fête nationale. Deux voitures piégées avaient explosé
faisant plus de trois cents morts et un millier de blessés.
Du monde entier, frappé de stupeur et
d’indignation, les soutiens et les aides affluèrent alors que l’attentat
n’était pas revendiqué.
Le gouvernement français, dépassé,
risquait d’être renversé. Le premier ministre accusa, au hasard, lors des
séances extraordinaires qui suivirent au Palais Bourbon
et au Palais du
Luxembourg, dans le plus grand désordre, les séparatistes basques, les
indépendantistes corses, les nationalistes bretons, les groupes
d’extrême-droite ou d’extrême-gauche, les groupuscules fascistes, les Libyens,
les Iraniens ou encore les Bulgares, les Palestiniens ou les Syriens. Puis, l’état
d’urgence fut décrété à l’unanimité, et ce, pour une durée de trois mois.
*****















