LE RETOUR DE L’ARTISTE
Par Christian et
Jocelyne JANNONE
Dédié à Jean Topart, décédé en décembre
2012, sublime sir Williams dans Rocambole

Chapitre premier
Il
faisait nuit. L’air chaud s’élevait du sol et cachait d’un voile brumeux les
étoiles qui éclairaient les ténèbres estivales de ce coin perdu du Piémont. Le
silence nocturne bruissait de mille sons. Parfois des criaillements excédés de
pies réveillées en plein sommeil et des coassements de crapauds montraient que
sur ces terres désolées, désertées par les hommes sous l’effet d’une peur
inavouable, la vie s’obstinait à exister.
La
chaleur était telle que des étincelles bleu vert fulguraient soudainement entre
les tombes ruinées et abandonnées depuis des lustres de l’antique cimetière. Un
sentiment d’angoisse saisissait l’éventuel voyageur égaré dans ces lieux
maudits que ce soit l’aube, le jour ou le soir, en été aussi bien qu’au cœur de
l’hiver.
Une
brise venue du nord venait de se lever. Elle rafraîchit avec bonheur
l’atmosphère moite de cette contrée sinistre. Toutefois la brume persistait,
s’insinuant entre les tombes et les caveaux noircis par la lèpre du temps alors
que le portail rouillé grinçait sous les coups d’un vent sans âme.
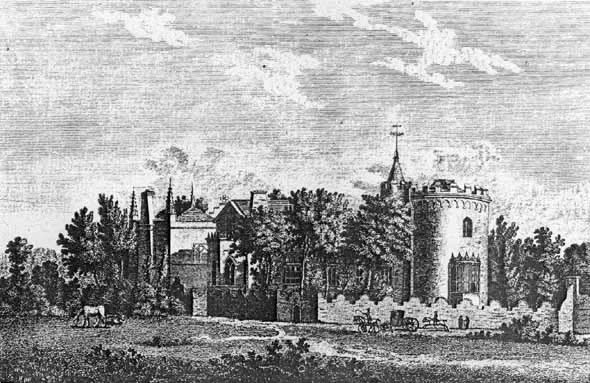
Impavide,
le temps s’écoulait, presque palpable. Un chat s’en revenait d’un festin
nocturne. Il avait fait bombance avec une paire de mulots. On ne sait pourquoi,
il se mit à miauler avec désespoir. Amours insatisfaites? Peut-être. Son ombre
s’estompa à proximité d’un monument en pierres noires dont les murs étaient à
demi effondrés.
Dans
cette partie du cimetière, la terre retournée par le lent travail souterrain,
laissait deviner du granit et des marbres épars, des croix brisées et
renversées, des os brunis, des crânes effrayants et des mâchoires béantes, tels
des anathèmes dressés contre un dieu insensible à la misère des hommes.
Tout
ce décor macabre ne troublait pas une chouette qui avait élu domicile sur le
tronc d’un chêne foudroyé par un violent orage il y avait déjà une dizaine
d’années.

Alors
que le ciel était serein, des grondements sourds et lointains se rapprochaient,
semblant venus de la nuit même. Soudainement inquiète, la vieille chouette
s’envola lourdement et ses ailes au plumage mordoré la conduisirent jusqu’à une
colline dominée par la masse sombre d’un haut donjon carré, dernier vestige
d’un château fort, témoin muet et centenaire des guerres qui avaient ravagé la
contrée. La tour du XIIe siècle se dressait dans le ciel de cette nuit peu
ordinaire du mois de juin 1866.
Un
observateur involontaire aurait capté des bruits étranges, comme nés
d’outre-tombe, des frémissements ou des halètements auxquelles se mêlaient des
lueurs blafardes et tremblotantes, fugitives, des fulgurances multicolores
recréant toutes les teintes de l’arc-en-ciel.
Dans
cet antre mystérieux, éclata le rire inextinguible, démentiel d’une créature
humaine, tel le fracas d’un coup de tonnerre; un ricanement glacial dont le
souvenir perdurerait dans la mémoire des êtres qui l’avaient surpris.
Accompagnant ce rire démoniaque, une voix rendue rauque par l’émotion, hurla en
italien:
«
Trema mondo! Ormai, sono il Maledetto! Une
fois encore je renais. Ma puissance est désormais sans égale. Fils dénaturé, je
reprends avec délectation le surnom dont tu m’avais affublé. Il claquera au vent
de ma colère et de ma vengeance. Le Maudit est vivant! Le Maudit est de
retour. »
À travers les interstices de la vieille porte
de la cave de la Tour, une silhouette massive se profilait, dévoilant à peine
l’homme vêtu d’un habit de soirée à la coupe impeccable, accompagné d’une ample
cape noire. Les yeux de nuit du Maudit n’étaient pas visibles.
***************
Paris,
mars 1867.
Le
Second Empire jetait ses derniers feux dans l’éclat d’une fête qui se voulait
permanente. Mais qui en était les acteurs? Les bénéficiaires et les privilégiés
du régime.

Depuis
quelques semaines, la presse parisienne, bientôt relayée par celle de province,
titrait sur les disparitions en série d’hommes de toutes les catégories
sociales. Chaque fois, le même scénario se déroulait, comme écrit par un
médiocre théâtreux avide de tirages à cent mille exemplaires. Les victimes
appartenaient toutes à la gent masculine. Elles s’évanouissaient dans la nuit,
que ce soit au cœur du vieux Paris, ou encore dans les nouveaux boulevards à
peine percés et les récentes avenues. La « zone » n’était pas oubliée
non plus, bien au contraire.
Marseille,
Lyon, Bordeaux tremblaient là leur tour bien que plus de la moitié des
disparitions eût lieu dans la ville Lumière.
La
Sûreté et la gendarmerie étaient sur les dents, menant leur enquête
conjointement pour la première fois, oubliant leur ressentiment passé.
Pourtant, les résultats se faisaient attendre. Aucune arrestation en vue, et
les enlèvements se poursuivaient à une cadence soutenue.
Préoccupante,
la situation l’était sans nul doute puisque Sa Majesté Napoléon III avait
présidé une réunion secrète qui s’était tenue au ministère de l’Intérieur. Le
Préfet de la Seine, celui de la Police, tous les colonels de la gendarmerie,
les principaux conseillers du Ministre de l’Intérieur, tout ce beau monde, tout
rutilant dans leurs uniformes galonnés, y avait participé, tentant de garder un
sang-froid trompeur devant l’inexplicable.
Un
étranger, d’origine russe, convoqué expressément par l’Empereur, était le point
focal de cette réunion extraordinaire. Dmitri Sermonov, le célèbre détective,
habituellement au service du tsar Alexandre II, avait daigné prêter son
assistance à Sa Majesté Impériale Napoléon III.

En
cette soirée du 2 mars 1867, tandis que la nuit s’avançait, Sermonov prenait
congé de ses illustres hôtes, les assurant de sa prochaine réussite. Sa voix
chaude et bien timbrée, son élégance naturelle, son regard de feu dans son
visage impassible au teint légèrement cuivré, dénonçant des origines
asiatiques, ses cheveux bruns coupés de frais, sa royale discrète, tout était
fait et arboré chez cet homme pour rassurer ses interlocuteurs.
-
Sire, croyez que j’apprécie sincèrement l’honneur qui m’est fait. Votre
confiance ne sera pas vainement accordée. Je réussirai. Donnez-moi cent jours.
Jamais je n’ai failli. Mon tsar bien-aimé vous l’a écrit. Il ne vous a pas
trompé.
-
Très bien, baron Sermonov. Allez, vous avez mon aval. Ma police et ma
gendarmerie, je vous le garantis, seront entre vos mains des outils tout
dévoués.
Sur
une dernière révérence et un sourire discret, Sermonov se retira enfin,
satisfait.
Une
fois à l’extérieur des bâtiments du ministère, le Russe fit quelques pas tout
en s’enveloppant frileusement dans sa pèlerine car une fine pluie froide
tombait sans discontinuer depuis neuf heures du soir, une pluie traîtresse qui
vous glaçait jusqu’aux os. Avisant un fiacre, le baron le héla demanda au
cocher de le conduire rue Serpente, devant une maison divisée en appartements
en location. Parvenu devant l’immeuble souhaité, il monta rapidement jusqu’au
deuxième étage et tira le cordon d’une sonnette. Une silhouette massive, au pas
lourd, un homme dans la pleine force de la quarantaine, un cigare aux lèvres,
un londrès, vint ouvrir. Avec impatience, le maître des lieux demanda:
-
Alors, c’est fait?
Il
s’exprimait en français sans aucun accent.
-
Sans problème… maître, répondit Sermonov, marquant toutefois une légère
hésitation comme s’il répugnait à reconnaître qu’il devait obéissance à
l’inconnu.
Satisfait,
l’Italien reprit, utilisant cette fois-ci sa langue maternelle.
-
Vous serez mes yeux dans la police de
cet histrion. Ainsi, je suis assuré de mener à bien ma vengeance.
-
Comme vous le dites, monsieur le comte, termina le serviteur pas si dévoué sur
un ton indéfinissable, se morigénant intérieurement de s’abaisser ainsi.
Quel
dommage pour notre noble italien de ne pouvoir lire dans les pensées de celui
qui avait revêtu l’identité factice de Dmitri Sermonov!
***************
En
cette matinée pluvieuse du 5 mars 1867, un steamer accostait sur un des quais
du port du Havre. Il venait de New York et la traversée de l’Atlantique n’avait
rien eu de remarquable malgré le mauvais temps car on approchait des tempêtes
d’équinoxe.
De
la passerelle des premières classes, une jeune femme blonde accompagnée de sa
camériste Emily descendit, portant son deuil et sa tristesse, toute de noir
vêtue, une voilette dissimulant ses traits réguliers et une vaste pèlerine sa
beauté sculpturale.

Puis,
ayant commandé un fiacre, l’inconnue se dirigea vers la gare où elle emprunta
un train pour la capitale. Le voyage qui suivit ne fut qu’ennui jusqu’à Paris.
Ensuite,
après avoir ordonné à sa domestique de rejoindre son hôtel particulier situé
sur les hauteurs du boulevard Saint Germain, la jeune femme se rendit dans le
faubourg Saint-Antoine chez sa sœur qu’elle n’avait pas vue depuis déjà trois
longues années.
La
cadette, prénommée Marie, était une adorable personne brune, quelque peu
enveloppée, vive et enjouée, et dotée de magnifiques yeux violets qui faisaient
oublier son obésité naissante. Mariée à un entrepreneur en ébénisterie, Marie
vivait heureuse dans ce quartier populaire et n’éprouvait aucun sentiment de
jalousie pour Louise, qui, elle, se complaisait dans le confort le plus raffiné
et le luxe.
Sa
joie fut donc grande de revoir son aînée mais la mine triste de celle-ci, ses
sombres vêtements lui firent aussitôt comprendre que le malheur venait encore
de frapper à la porte de Louise.
-
Ma Louison, ma Louisette! C’est Henri, n’est-ce pas? Murmura Marie de sa voix
douce.
-
Oui, sœurette, hélas. Il y a deux mois. Henri s’est noyé alors que nous
effectuions un voyage le long du Mississippi, remontant le fleuve jusqu’à
Saint-Louis. Seule dans ces Etats-Unis qui relevaient tout juste de la guerre
civile, désemparée, j’ai décidé de revenir en France malgré tout ce que j’avais
souffert dans mon pays natal.
-
Tu as bien fait. Je t’approuve. Je compatis à ton chagrin. Le comte de
Frontignac était un noble cœur. J’étais contente que tu aies enfin trouvé le
bonheur.
-
Henri connaissait pourtant mon passé agité. Je ne lui avais rien celé. Mais il
s’en moquait. Il n’avait que faire du qu’en dira-t-on. Que lui importait que je
me fusse appelée Brelan d’as, la demie mondaine pour qui tout Paris se battait
afin de recevoir un sourire ou un simple regard!

-
Mais l’amour, l’authentique amour t’a touchée de sa grâce et cela a mis un
terme à toutes tes folies. Maintenant, que vas-tu faire ma Louison?
-
Rien pour l’instant si ce n’est me reposer. J’ai tout le temps de réfléchir. Ne
suis-je pas désormais une veuve respectable, à l’abri du besoin? Le destin a de
ces ironies!
-
Ma Louisette chérie, ne sois pas si amère.
-
Comme toujours, tu as raison, Marie. Tu es la plus mûre de nous deux. Mais j’ai
hâte de connaître les dernières nouvelles de France. Il y a si longtemps que je
suis partie.
-
Jacques, ton neveu, a maintenant six ans et il commence à lire. Léon se porte à
merveille. Les affaires marchent. Nous envisageons de prendre un ouvrier
supplémentaire.
-
Mais nos amis?
-
Saturnin de Beauséjour vit une retraite paisible grâce à la munificence de don
Iñigo.
-
Bien. Cela ne m’étonne pas de Frédéric. Que devient-il à propos?
-
Aucune nouvelle depuis l’affaire de la machine de Marly.

Il s’est littéralement
évaporé dans la nature. La police pense qu’il est mort. En fait, cela
l’arrange.
-
Permets-moi d’en douter, sœurette. Ce n’est pas là une fin digne de Frédéric
Tellier.

Dire que toutes deux, nous lui devons tant.
-
La vie, tout simplement.
-
Ah! Si mon influence avait été plus grande auprès de la Justice, surtout auprès
de ce Grandval, j’aurais fait annuler le jugement du Premier Tribunal de Paris.
-
Certes. Mais nous ne pouvons pas récrire l’histoire. La nation devrait être
reconnaissante envers don Iñigo. N’a-t-il pas dévoilé un complot qui mettait en
cause la liberté de conscience des plus hauts dignitaires du régime? La
Russie s’y trouvait mêlée si je me souviens bien.
-
En effet. Qu’a-t-il reçu en récompense pour tout le mal qu’il s’est donné?
Rien! Il s’est fondu dans la nuit une nouvelle fois.
-
Tu sais, depuis janvier, il se passe des choses étranges. Comme si l’affaire de
Marly recommençait.
-
Quoi? Les disparitions ont repris?
-
C’est cela. Elles concernent des Français en majorité et, chose nouvelle, de
toutes conditions. Aucun des disparus n’a été retrouvé.
-
Serait-ce encore et toujours le Maudit?
-
Je le crains grandement… soupira Marie.
-
Que nous réserve le destin? Pourquoi s’acharne-t-il sur notre pays? Dois-je
donc combattre ce comte infernal? Seule, sans appui? Je me sens si lasse!
-
La presse annonce qu’un détective russe, le baron Sermonov, est chargé de ce
mystère. Il n’y a plus qu’à espérer qu’il réussisse et que l’orage nous épargne.
-
Pourquoi un Russe?
-
Je ne comprends pas…
-
Je demande pourquoi un Russe a-t-il reçu tout pouvoir dans cette histoire?
-
Euh… peut-être le tsar sent-il qu’il a des obligations envers notre pays? Après
tout, il y a trois ans, la Russie s’est retrouvée en première ligne face aux
manigances du Maudit. Di Fabbrini se servait des ambitions d’un prince tatar
pour s’emparer du pouvoir ici et à Saint-Pétersbourg. Ce complot bénéficiait du
soutien d’une partie des boyards.
-
Une chose est certaine. Je n’ai pas à me mêler à ce combat. J’aspire au repos.
-
Ma Louisette, j’enregistre tes paroles.
-
Moi, une femme, une veuve, que pourrais-je?
-
Beaucoup si Frédéric Tellier était à tes côtés. Or il semble que toutes ces
luttes appartiennent désormais au passé. Restes-tu dîner?
-
Non, Marie. Navrée de te décevoir. Je le regrette, mais il me faut rejoindre
mon hôtel. Je n’ai qu’une confiance limitée en mes domestiques. Je dois
surveiller mon emménagement. Emily parle si mal le français.
-
Tant pis, Louison. Mais tu reviens bientôt, n’est-ce pas?
-
Promis, petite sœur. Je t’enverrai un mot dès que je serai plus disponible.
J’apprécie énormément de vivre quelques heures dans ta famille.
Après
s’être embrassées affectueusement, les deux jeunes femmes se séparèrent.
Un
peu moins de trente minutes plus tard, Louise de Frontignac pénétrait dans son
hôtel particulier. Il s’agissait d’une grande bâtisse construite il y avait
près de deux cents ans déjà, entourée d’un mur d’enceinte gris aux vieux
moellons de pierres usées et moussues dont la porte cochère, en mauvais état,
ne payait pas de mine.
La
construction centrale, sur trois niveaux, comportait un perron et un escalier
de calcaire. Le bâtiment alternait la pierre de taille et la brique dans un
style qui oscillait entre le Louis XIII attardé et le Grand Siècle tâtonnant.
Le toit d’ardoise mêlait ses camaïeux à ceux du ciel parisien. Les fenêtres
hautes, closes par des tentures de velours sombre, ne laissaient rien deviner
des secrets intérieurs de la demeure jusque-là vide.
Le
perron conduisait à un vaste hall dallé de carreaux blancs et noirs. Un grand
salon, autrefois salle de bal, peu meublé, dont la porte n’était
qu’entrouverte, laissait entrevoir son lustre passé. Un escalier de marbre,
courbé, à rampe en fer forgé, mena la locataire des lieux jusqu’à ses
appartements, situés au premier étage, composés d’un boudoir, d’une garde-robe
imposante par sa taille et d’une chambre décorée dans le plus pur goût décadent
du règne de Louis XV. Tapisseries, coiffeuse, fauteuils et lit, tout était
authentique et dégageait une légère fragrance fanée, évoquant ainsi la
nostalgie d’une époque à jamais révolue.
Mais
Louise de Frontignac se souciait fort peu de succomber au charme passéiste de
cette pièce autrefois habitée par une marquise, une arrière grande tante de feu
son époux, une ci-devant noble guillotinée sous la Terreur. Lasse, ô combien,
elle se laissa dévêtir par sa camériste avant de réclamer une tasse de chocolat
chaud. Puis, elle demanda à Emily des nouvelles de ses malles et les
rendez-vous du lendemain avec le tapissier, le décorateur, l’ébéniste, la
modiste, la coiffeuse et ainsi de suite…
Enfin,
Louise décida de se rendre elle-même chez un voiturier afin d’y louer chevaux
et calèches nécessaires à ses équipages.
La
nuit tombée depuis longtemps, la comtesse de Frontignac congédia alors sa
domestique et, les mains en coupe sous son menton, le visage nimbé par la douce
lumière provenant de la lampe à pétrole posée sur un charmant guéridon, jetant
parfois des éclats dorés sur ses cheveux coiffés en bandeaux, elle réfléchit à
ce qu’il lui fallait faire. Les heures s’envolèrent sans qu’elle n’en prît
conscience…
***************
Le
même soir, dans l’Île de la Cité, une petite rue proche du quai aux fleurs, où
les réverbères étaient rares, et dont les pavés luisant de pluie devenaient
glissants, s’endormait dans la quiétude d’une nuit quasi printanière. A l’abri
derrière leurs volets clos, les habitants du quartier connaissaient les heures
de la tournée nocturne du sergent de ville, qui, consciencieux, arpentait
quotidiennement cette modeste artère. L’homme, la quarantaine bien sonnée, la
moustache déjà grisonnante, marchait d’un bon pas sur les pavés inégaux, tout
emmitouflé dans sa pèlerine, regrettant toutefois de ne pouvoir tirer quelques
bouffées de sa pipe remisée dans une blague à tabac. Il était de service donc
pas question de céder à ce petit plaisir!
Poursuivant
sa ronde méthodique, le représentant de l’ordre public, l’ouïe quelque peu
durcie, ne prêta nullement attention à des bruits furtifs venant d’un
renfoncement enténébré. L’auteur de ces frôlements suspects était un personnage
de grande taille à la silhouette massive et à la carrure impressionnante. Vêtu
avec une élégance recherchée d’un habit parfaitement coupé, d’une cape de
soirée et coiffé d’un chapeau claque, tenant à la main une lourde canne à
pommeau d’ambre, le visage à la mâchoire carrée, les traits dissimulés par un
loup noir, l’inconnu se mit à avancer dans la ruelle si paisible d’un pas mécanique
et pesant, mû par une volonté inconsciente car ses yeux d’où toute intelligence
semblait absente, ne voyaient pas. Était-ce donc un mort qui marche?

Un
rat, effrayé par la marionnette humaine dépourvue d’âme, passa entre les jambes
de la créature pour se fondre rapidement dans l’obscurité. Le robot biologique
ne se rendit compte de rien et ne vit ni ne sentit le rongeur aux yeux jaunes.
Il n’entendit pas également le froissement d’une manche sur la pierre moisie,
manche appartenant à un surineur avide d’un coup de poignard. Ainsi, une lame
luisit subitement sous la clarté douteuse et tremblotante d’un réverbère à gaz.
Le couteau s’enfonça aisément dans le dos de l’inconnu. Le coup fut porté trois
fois mais pourtant la victime ne s’effondra pas, ne poussa aucun cri ou
gémissement, pas même un soupir.
Incroyablement,
le poignardé se retourna vers son assaillant, son visage n’exprimant rien que
le vide, l’impavidité de la mort.
Alors,
les bandits, au nombre de deux, reculèrent, pétrifiés de peur, cherchant à se
confondre avec le mur de la vieille maison qui leur avait servi de cachette. Le
plus chétif des agresseurs ne put retenir une exclamation.
« Ô
Bonne Mère! Protège-moi! », dans laquelle l’accent marseillais ressortait.
La
panique des deux malfrats fut à son comble lorsque la victime, poursuivant sa
marche mécanique vers ses assassins, le visage toujours aussi inexpressif, leva
les bras et parla à son tour d’une voix sépulcrale.
«
Monseigneur! Mon Maître! Rendez-moi mon âme! ».
L’homme,
disant cela, avançait tel un zombie, le couteau toujours enfoncé dans le dos.
S’agissait-il d’une véritable scène d’épouvante sortie tout droit des films de
la Hammer?

C’en
fut trop pour nos surineurs qui prirent leurs jambes à leur cou et s’enfuirent,
échappant de justesse au sergent de ville, qui, en bon serviteur de l’Etat,
terminait sa ronde, ignorant ce qui se passait à trois cents mètres de lui à
peine. Mais l’homme masqué, avançant de son pas égal, finit par se heurter au
fonctionnaire. L’effet fut le même qu’avec les deux pègres. Le policier à son
tour terrorisé, entendit distinctement l’individu sans conscience s’écrier:
«
Maître, quand me rendrez-vous mon âme? ».
Perdant
son sang-froid, le sergot se mit à courir à perdre haleine, rejoignant en
quelques minutes le commissariat le plus proche, où, après avoir avalé un doigt
d’eau-de-vie, il fit son rapport à son supérieur dans un langage si peu clair
que personne ne comprit ce qui était arrivé.
Pendant
ce temps, rue Beaubourg, où le Piscator et Marteau-pilon avaient trouvé refuge,
les dîneurs attardés ne prêtaient aucune attention aux deux malfaiteurs qui
cherchaient à reprendre leur souffle, le visage en sueur malgré la température
pas si clémente. Les deux amis récupéraient peu à peu tout en s’interrogeant
sur le mystérieux automate humain qu’ils avaient agressé avec l’intention de
lui faire sordidement les poches.
-
Ce zig n’était pas normal! Jeta le Piscator entre deux quintes de toux.
-
Pour sûr! Approuva Marteau-pilon. Il venait sans doute de l’enfer.
-
Surtout n’emploie pas ce mot. Il me fait peur! Trembla le Marseillais.
-
Pourtant, je n’en vois pas d’autre. Tu as une explication pour ce mannequin de
chair? Il saignait comme toi et moi. Mais il marchait, continuait d’avancer
comme si ton coup de surin ne lui avait rien fait. Nib de nib!
-
J’en frissonne encore. J’comprends rien à ce qui s’est passé. Je ne suis qu’un
voleur, un monte-en-l’air. J’ai jamais été à l’école sauf à celle de Brest ou
de Toulon.
-
Pareil pour moi. Ah! Quel dommage que l’Artiste nous ait quittés! Lui saurait
le fin mot de cette histoire plus vite que je ne vide mon godet.
-
Tu dis vrai. En attendant, nos poches restent vides. Encore une fois, nous ne
souperons pas ce soir.
-
Le ventre vide, je dors mal.
Sur
ces regrets fort prosaïques, nos tristes sires regagnèrent leur logis sordide
dans le troisième arrondissement de Paris, une venelle à proximité des halles,
qui, déjà, s’animaient.
***************
